Discographie Dvorák
Neuvième symphonie
« Du Nouveau Monde » - « From the New World » opus 95 / B. 178
Galliera, ø avant 1968 O. Philharmonia - Trianon TRX 6 110 [LP]
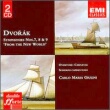
Giulini [1], ø 1961 Philharmonia O. - Emi
"Double Forte" 68628 (+ 7e & 8e, Ouverture Carnaval, Scherzo
Capriccioso op. 66)
Durées : I. 9'16 - II. 12'33 - III. 7'51 - IV. 10'17 = 40'55
8/7 Rép. n° 85 / 4Y Diap. n° 420 / 3d Compact n° 35
« S'il manque ici cette gravité et cette mélancolie slave qui font la puissance de versions comme celles de Ancerl, le climat pastoral, la poésie, le naturel de la direction, la magnificence des timbres de l'orchestre font de cette Neuvième un véritable régal pour les sens. » (Bruno Serrou, Compact n° 35)
« La redécouverte des « premières moutures » giuliniennes est source de surprises, surtout en regard du récent naufrage de ses Dvorák chez Sony [de 1993]. Il n'y a pas une trace d'atonie dans ces gravures, qui bénéficient d'une profondeur sonore et interprétative touchant au sublime [...] « Largo » de la Nouveau Monde). La ciselure de la pâte orchestrale, avec des cordes graves d'une présence superbe [...], l'impatience à peine contenue, la main de fer qui guide le discours avec fluidité [...] marquent véritablement la discographie des 7e et 8e, plus, sans doute que de la 9e, si extraordinairement servie par les tchèques et hongrois. On relèvera avec plaisir l'impitoyable et magistrale conception « en arche » des mouvements et des oeuvres, tendues (même si on peut souhaiter cette tension encore plus « nerveuse ») vers leur irréductible destinée (ce à qui fait également l'art de Furtwängler ou Celibidache). » (Christophe Huss, Répertoire n° 82)
A lire aussi la page anglaise de Robert M. Stumpf II.

Giulini [2], ø 1977 OS. Chicago - DG "Galleria" 423 882-2 (+ 8e Schubert) [2530 881 - LP]
Durées : I. 12'12 - II. 13'40 - III. 8'13 - IV. 11'43 = 45'48
4Y Diap. n° 224 & 420 / 4d Compact n° 35
« Il y a dans son interprétation un équilibre rarissime entre la rigueur implacable qui suit les indications de la partition avec une minutie d'orfèvre, et une volonté expressive très subtile qui, loin de s'opposer à la lettre, en transcende les effets. [...] Le miracle, c'est que la perfection ainsi désirée et obtenue devienne aussi naturelle, et l'on s'étonne qu'aucun chef ne soit encore arrivé à traduire d'une telle manière le choral de cuivre du Largo, le rythme « con fuoco » du Molto vivave. Est-il nécessaire d'aligner les superlatifs ? » (Jean-Yves Bras, Diapason n° 224 - janvier 1978)
« [Ici] tout est fabuleux ! : dès le début de la Nouveau Monde, en effet, nous sommes saisis par ses accords coupés au couteau, par son aspect vivant, dynamique, son modelé exceptionnel et les infaillibles sonorités de l'Orchestre de Chicago qui respire amplement, sautillant léger, plein d'une bonheur que nous recevons comme une bénédiction, avec une sublime constance. » (Jean Gallois, Compact n° 35)
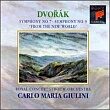
Giulini [3], ø 1992 O. Royal Concertgebouw
- Sony SX2K 58 946 (+ 7e)
Durée : 46'56
5/8 Rép. n° 70 / 4Y Diap. n° 405 / 1* Monde n° 179
« Ces disques procèdent de tout ce qu'on voudra, mais pas d'un rendu musical d'une symphonie tchèque. On y trouvera heureusement une culture orchestrale exceptionnelle, qui permet à l'orchestre de suivre les parti pris du chef, mais surtout au chef de se reposer sur lui. Ainsi la couleur charnue des violons, l'accentuation de contre-chants des cuivres à la fin du 1er mouvement de la 9e ou dans la coda de cette symphonie, la qualité intrinsèque des bois (chapeau de garder une telle qualité d'émission dans un « Largo » de Nouveau Monde étiré sur 15'28 !) sont sollicités à l'extrême. On cherchera ensuite à qualifier le style... tâche sérieusement délicate ! On a l'habitude d'invoquer Brahms en écoutant un Dvorák germanisé. Giulini va beaucoup plus loin, traçant une sorte d'arche à la fois apaisée et boursouflée entre la Grande de Schubert et la 8e de Bruckner ! Toute l'expression possède la profondeur de la première mâtinée de la grandeur péremptoire de la seconde. C'est évidemment un hors-sujet complet dans ces symphonies. Nous voilà donc au coeur du « système esthétique » giulinien (ce fut jadis un univers, mais il semble avoir perdu sa richesse et sa diversité pour devenir un système). Parfois ce système nous happe [...], parfois il nous exclut [...]. En oubliant totalement que l'on est censé écouter sur Dvorák, on pourra ici se laisser gagner par la noblesse puissante, phénoménalement structurée et débordante de couleurs changes de la 7e, mais on restera extérieur à une Nouveau Monde qui apparaît de plomb et de grosse intentions (quelles lourdeur dans les mouvements extrêmes !) Un coffret désappointant, même pour les admirateurs du chef. » (Ch. Huss, Répertoire n° 70)
« Le grand chef italien Carlo Maria Giulini est un habitué du monde symphonique dvorakien qu'à la manière d'un Bruno Walter il fait visiter avec la chaleureuse bienveillance d'un guide rendant d'abord hommage au modèle plus pastoral qu'impérieux de la forme symphonique brahmsienne. Sa lecture de la Symphonie en ré mineur est aujourd'hui encore plus ralentie que celle de 1976 au pupitre du London Philharmonic (EMI). Chef scrupuleux et inspiré, il fait de Dvorák un héritier direct de la tradition viennoise, du Mozart « jupitérien » comme du Schubert « tragique ». Contrairement aux chefs slaves, sa battue procède par larges plages, et se refuse à faire avancer le discours par le seul continuum rythmique à la manière post-wagnérienne d'un Talich, puis de ses successeurs, Neumann (Supraphon) et Belohlavek (Chandos). Malheureusement la magnifique phalange du Concertgebouw d'Amsterdam ne le suit pas toujours avec une parfaite cohérence [...]. Les tempos sont encore plus retenus qu'à Chicago (DG, 197[7]). Mais Giulini les assume avec une plénitude, un sens de la mélodie continue que seuls peut-être avant lui Kubelík, Walter ou Karajan (parfois) avaient atteints. La partition ne perd rien de sa puissance émotionnelle et s'inscrit alors dans la tradition romantique. Malheureusement quelques petits décalages apparaissent parfois à l'orchestre, tandis que Giulini n'obtient pas toujours la perfection d'articulation que sa conception exigerait. Les timbres sont beaux, mais leur magie ne rayonne que de façon intermittente en une immédiate splendeur. Une «Nouveau Monde » décantée et généreuse, d'un classicisme inspiré, à éditer séparément tant une telle conception fait défaut au sein d'un catalogue dominé par l'école d'Europe centrale. » (Pierre E. Barbier, Diapason n° 405)
« On s'ennuie terriblement. Le chef italien a beau, ici ou là, souligner un détail d'orchestration inconnu, comme pour se donner meilleure conscience d'aller aussi effrontément à l'encontre des tempos et des nuances indiqués par le compositeur, l'enthousiasme a quitté le navire et l'intérêt avec lui. Irréprochable quant à lui, le Concertgebouw réussit la performance de ne pas être insupportablement lourd dans les mouvements rapides et de tenir la tête hors de l'eau dans les mouvements lents (héroïque cor anglais, qui ne s'étouffe pas dans le «Largo» [...] » (Pascale Colas, Monde n° 179)
Greene, ø avant 1968 ? London Festival S. - Musidisc RC 814 [LP]

Groves, ø 1975 OS.
BBC - IMP 9102
Durée : 40'00

Gunzenhauser, ø 1990 OP. Bratislava - Naxos
8.506 010 (intégrale)
Durée : 43'00
5/5 Rép. n° 51 / 3Y Diap. n° 393
« Mieux contrastées, les Symphonies n° 4 et 9 [par rapport aux sept autres] manquent, en contrepartie, de cohérence : une agitation un peu vaine parcourt la « Nouveau Monde », [...]. Bref, l'examen détaillé de chaque mouvement déçoit légèrement par rapport à l'impression globalement favorable que donne le cycle entier. Et il en va de même pour l'orchestre : capté avec beaucoup d'ampleur dans la salle Reduta de Bratislava et manifestement rompu à ce répertoire, le Philharmonique Slovaque peut néanmoins difficilement rivaliser, sur des points précis, avec les meilleures formations internationales (les cordes sont parfois stridentes [...]) En fait, cette méritoire intégrale ne souffre que d'une faiblesse relative, mais pratiquement insurmontable en raison de l'exceptionnelle richesse discographique dont bénéficient aujourd'hui les symphonies de Dvorák [...]. » (Francis Drésel, Diapason n° 393)
Toutes suggestions, corrections ou informations
supplémentaires sont bienvenues !
http://patachonf.free.fr/musique