Discographie Berlioz
Symphonie Fantastique
M
Maazel [1]
ø Concert 1961 - RIAS Berlin
* LP : Longanesi GCL 18 / I grandi concerti
Durées : I. 13'29 - II. 5'44 - III. 17'35 - IV. 4'10 - V. 9'00
Maazel [2]
ø 1980 - O. de Cleveland
* LP : CBS 76 652 (p 1981)
* CD : CBS "Maestro" (p 1987)
Durées : I. 12'54 - II. 5'57 - III. 16'49 - IV. 4'04 - V. 9'03 = 49'07
« Une bien curieuse version qui attirera spécialement l'attention des berlioziens. Sur le plan de l'exécution orchestrale, Maazel conduit brillamment l'orchestre de Cleveland, plus rutilant que jamais, dans cette oeuvre où la science orchestrale de Berlioz fait déjà merveille. L'interprétation, pas toujours axée sur les profondeurs du mystère, un peu objective dans "Rêveries", un peu froide pour les émotions pastorales de la "Scène aux champs", est, cela ne surprendra personne, plus convaincante dans les épisodes qui mettent en valeur la nervosité volcanique de l'auteur... Le "Songe d'une nuit de Sabbat" a tout le relief diabolique et la "Marche au supplice" toute la vigueur farouche, tout l'éclat barbare que l'on peut souhaiter. Ce qui surprendra, voire choquera le plus, c'est l'aspect très inhabituel du "Bal", que l'on connait pour son atmosphère de fête brillante et aristocratique dominée par l'élégance de la valse des cordes et des traits de harpes. Or, l'on entend ici un superbe solo de cornet à pitons qui transforme la soirée 1830 en réjouissance bavaroise, et fait commencer le Sabbat avant le crime. Et bien, cette trahison est authentique et Maazel ne fait que suivre un remaniement ultérieur de la partition de Berlioz. Il faudrait réaliser une discographie comparée pour s'en assurer, mais il me semble que Maazel doit être le seul à observer cette retouche [*] qu'il est permis de trouver intempestive, mais qui respecte les intentions ultimes de l'auteur. » (Monique Escudier, Harmonie [nouvelle série] n° 8 - avril 1981)
* avant Maazel, Klemperer, C. Davis, Mehta, J. Martinon avaient ajouté la partie de cornet à pistons dans leurs enregistrements. (Robert C.)
« Comme dans la version Telarc enregistrée avec le même orchestre, Maazel se montre nerveux et ferme, attentif aux indications de la partition. Malheureusement, cette grande honnêteté intellectuelle s'accompagne - ici aussi - d'une trop grande objectivité, le contraire de ce que l'on peut souhaiter pour pareille oeuvre. Il y manque en effet ce grain de passion, voire de folie, qui nous eût séduits, bouleversés ou glacés d'effroi (dans "la Nuit de Sabbat" par exemple). Ceci dit, la prestation de Cleveland est superbe. » (Jean Gallois, Compact n° 25 - novembre 1987)
Maazel [3]
ø Cleveland, Severance Hall, 10 mai 1982 - O. de Cleveland
* LP : Telarc DG-10076 (p 1982)
* CD : Telarc CD-80976
Durées : I. 12'27 - II. 5'59 - III. 16'19 - IV. 4'04 - V. 9'21 = 54'54
Maazel [4]
ø 23 février 2000 - OS. de la Radio Bavaroise
* CD : En Larmes S 01 52/3 S (Parnassus)
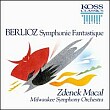
Macal [1]
ø 1989 - OS. Milwaukee
* CD : Koss 1005 (p 1993)
Durées : I. 13'36 - II. 6'08 - III. 15'26 - IV. 4'31 - V. 9'39 = 49'19
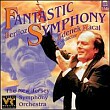
Macal [2]
ø oct.-déc. 1997 - OS. New Jersey
* CD : Delos DE 3229 (+ op. 17 - p 1998)
Durées : I. 13'43 - II. 6'14 - III. 16'40 - IV. 4'24 - V. 9'42 = 51'07
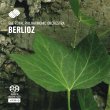
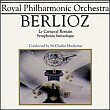
Mackerras
ø Londres, CTS Studios, janvier 1994 - RPO
* CD : Emi / Intersound 2831 / Tim Company "Allegria" 221001205 (p 2003 + Carnaval Romain)
Durées : I. 14'34 (reprises) - II. 6'00 - III. 15'44 - IV. 6'44 (reprises) - V. 9'48 = 53'17

Mardjani
ø 1994 - Georgian Festival O.
* CD : Sony Infinity / Prism Classics
Durées : I. 14'34 - II. 6'21 - III. 17'38 - IV. 5'03 - V. 10'17
Cet enregistrement a paru en CD avec le pseudonyme Andreas Spörri, dirigeant soit disant l'O. de Tblisi et daté de 1996 chez HDC/Beaux Arts.


Igor Markevitch [1]
ø Concert 18 septembre 1952 - OS. Radio Berlin
* CD : Urania 202 (+ Parade, Satie) / Arkadia CDGI 748 (p 1991 + La Mer-1967)
Durées : I. 13'28 - II. 5'46 - III. 15'12 - IV. 4'24 - V. 10'10 = 49'41
4* Monde de la musique n° 270
« Ecoutez comme [Igor Markevitch] enflamme son orchestre à la fin du premier mouvement, ou comme il entraîne les cordes dans un mouvement perpétuel dans la coda du deuxième. Cérébral et fougueux à la fois, il sait aussi se laisser aller dans les sauvages fanfares de la marche au supplice, avant de faire hurler les cuivres lors de la dernière apparition du « Dies Irae ». Certes, il a fait mieux en studio avec le Philharmonique de Berlin et l'Orchestre Lamoureux [...]. » (Pablo Galonce, Monde de la Musique n° 270 p. 70 - novembre 2002)

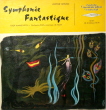

Igor Markevitch [2]
ø Berlin, Jesus-Christus Kirche, 23-29 novembre 1953 - Orchestre Philharmonique de Berlin
* LP : DG LPM 18 167 (+ Jeux d'enfants/Bizet) / "Prestige" 18 167 (fr)
* CD : DG "Centenary Collection" 459 015-2 (+ Tableaux de Moussorgsky)
Durées : I. 13'19 - II. 5'50 - III. 14'39 - IV. 4'27 - V. 10'07 = 48'22
9 Répertoire n° 119
« ... La nouvelle version me paraît surpasser Monteux et Otterloo, tant du point de vue de l'enregistrement que de l'interprétation. Markevitch trouve dans la «Fantastique» une oeuvre qui convient miraculeusement à son tempérament d'interprète et je conseille à ceux qui croient avoir «fait le tour» de cette oeuvre, ou en avoir épuisé les richesses expressives, d'écouter ce disque... Voici donc une interprétation qui va plus loin que les autres dans le respect des nuances exigées par le compositeur et dans l'emportement comme dans le mystère... » (H.L. de la Grange, Revue « Disques » n° 70 - février/mars 1955)
« Markevitch, comme, à sa manière le jeune Maazel, métamorphose littéralement l'orchestre de Furtwängler en le dégermanisant de fond en comble. Les timbres transparents et tendus (les cordes), la finition impeccable de la mise en place, la pureté des lignes, les recherches originales de coloris dans les graves et les aigus (des cuivres et des bois à la fois tranchants et fluides) font merveille dans cette Fantastique, véritable redécouverte discographique. Dans l'ensemble plus vive que celle avec Lamoureux [1961], plus austère aussi, elle établit le modèle d'une interprétation classique, à l'abri de toute exagération folklorique (Stokovsky...) ou de tout sentimentalisme narratif. [...] Tout juste pourrait-on souhaiter un peu plus d'abandon poétique dans la « Scène aux champs » sa deuxième version est là plus habitée) et d'emportement frénétique «à la Munch» dans la coda du « Songe d'une nuit de sabbat ». Mais comme Monteux, Markevitch n'est pas homme à perdre la tête devant une assemblée satanique... » (Jean Marie Brohm, Répertoire n° 119)

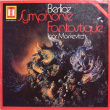
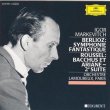
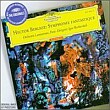
Igor Markevitch [3]
ø Paris, salle de la Mutualité, janvier 1961 - O. Lamoureux
* LP : DG "Privilege" 2538 092 / SLPM 138712 (p 1963) / Heliodor 2548 172 / Eterna
* CD : DG "Originals" 447 406-2 (p 1995) / "Dokumente" 423 957-2 (p 1988)
Durées : I. 14'15 - II. 6'08 - III. 15'58 - IV. 4'48 - V. 11'03
10 Répertoire n° 9 / Diapason Historique n° 343
« Markévitch a-t-il renouvelé la réussite de sa 1e version ? Il m'est difficile de répondre de manière absolue. Il ne s'agit pas d'une version romantique ni - en apparence tout du moins - très « engagée ». Cependant, le style est personnel, surprenant parfois... Alors ?. Au crédit : « Un Bal » et la « Scène aux champs ». La « Valse », à défaut de sa poésie brumeuse d'antan, garde une élégance rare... La « Pastorale » introduit ensuite la détente nécessaire. Je suis plus désorienté par les autres mouvements : Largo (1er mouvement) placide, «Marche» fignolée mais sans angoisse ni hallucination. Quant au « Finale », s'il nous impressionne, c'est plus par sa sinistre obstination que par la « re-création » d'un climat fantasmagorique. Voilà bien des réserves. Il va sans dire qu'elles se situent à un niveau de qualité très élevé : en « valeur absolue », cette Fantastique demeure satisfaisante. Mais Argenta, Monteux, Frémaux ont su nous convaincre davantage. » (Claude Dutru, Revue « Disques » n° 130 - novembre/décembre 1962 [dernier numéro])
« La Fantastique de Markevitch est d'une rigueur racée et d'une puissance granitique. On admirera également le merveilleux travail de l'Orchestre Lamoureux qui se hisse ici au niveau des grandes phalanges internationales (la « Scène aux champs » est d'une lisibilité confondante). » (Jean-Marie Brohm, Répertoire n° 9)
« Cette Fantastique de 1961, quelque peu oubliée, est justement une version exceptionnelle : le premier mouvement, prodigieusement varié, a toute la fantaisie requise, le Bal est enfin une vraie valse, et la Scène au champs ateint des sommets de poésie. En revanche le finale manque d'un rien de folie, Markevitch donnant l'impression de presque trop « dominer » l'oeuvre. » (Diapason n° 343 p. 123 - novembre 1988,
Martinon [1]
ø 1953 - OS. de la NHK
* CD : King KICC 3028
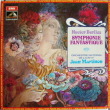
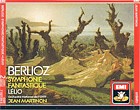

Jean Martinon [2]
ø Paris, Salle Wagram, 19-29 janvier 1973 - O. National de l'ORTF
* LP : Emi C069-12 512 / Q4ASD 2945
* CD : Emi "Rouge et Noir" 5 85124 2 (p 2003 + Lelio) / CZS 7 62739-2 (p 1989 + Lelio)
Son : P. Vavasseur
Durées : I. 15'08 - II. 6'42 - III. 17'22 - IV. 4'53 - V. 9'57
7/6 Répertoire n° 63 (comparatif), 6/6 n° 20, 171 / 3Y Diapason n° 355 / 4d Compact n° 48 / 3*** Penguin Guide
« Les cordes sont pâles, les cors vibrent et manquent de rondeur, l'harmonie d'ensemble est bien pauvre. Seuls les bois, comme d'habitude, s'en sortent bien, en particulier le cor anglais. Martinon, qui s'en tient sagement à une facture très classique, sans excès ni emportement, ne peut que difficilement éviter quelques flottements de mise en place, des phrasés qui sentent l'absence de finition (« Un Bal »), la relative dispersion harmonique. Bien sûr, l'esprit de l'oeuvre est bien respecté avec sa liberté et son « émouvante lutte d'éléments » comment disait Debussy. La seule réussite incontestable est la « Scène aux champs », sereine et pastorale à la fois, presque beethovenienne. » (Jean-Marie Brohm, Répertoire n° 20, décembre 1989, p. 30)
« La vision parfaite de Jean Martinon [est] digne de Monteux [...]. Le premier mouvement a cette démarche souple, ce rubato génial est la base même de l'agogique naturelle de cette oeuvre qu'il devrait être impossible de conduire linéairement. De même, Martinon sait ce qu'est une valse, de Strauss à Ravel, de Mahler à Prokoviev ! Mais, dès la Scène aux champs, l'orchestre semble ne plus le suivre qu'artificiellement. Même si les bois solistes sont remarquables, le climat pastoral n'a plus la continuité que la battue de Martinon devrait inspirer. Avec la Marche au supplice et le Songe d'une nuit de Sabbat, le décalage entre la perfection de tempo, et rubatos, de respiration du chef ne se transmettent qu'avec une confusion grandissante dans la réalisation ! » (Pierre-E. Barbier, Diapason n° 182 - décembre 1973)
« Avec Martinon la Fantastique sort d'un rêve, s'anime peu à peu, se déchaîne, en arrive à une sorte de fascination qui se love sur elle-même (voyez comment réapparaît le thème de l' «idée fixe»...). Dans la « Scène du bal », le chef inclut le cornet à piston que Berlioz ajouta bien après 1830 ; l'oeuvre y perd peut-être en noblesse, mais y gagne en effets romantiques, avec cette immixtion du réel dans l'onirique, du grotesque dans l'idéalisme. La « Scène au champs » prend alors toute sa dimension pastorale, intensément dramatique, que ses tensions et exigences stylistique à une sorte de paroxysme. Dans les deux derniers mouvements, Martinon - ou l'Orchestre National ? - lâchent un peu pied et deviennent davantage objectifs bien ordonnés, supérieurement traités. Mais la belle illusion, le noble enchantement précédent se muent en une réalité beaucoup moins «fantastique». parce que Martinon, trop pur ne veut tricher ni avec le public, ni avec une partition plus réaliste, alors qu'avant il s'enivrait et nous subjuguait de tout ce que l'oeuvre apportait de nouveauté et de folie. Réserve qu'il convient toutefois de ne point grossir, car la prestation demeure électrisante et d'un goût parfait. » (Jean Gallois, Compact n° 48)

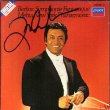
Mehta [1]
ø octobre 1979 - P. New York
* LP : Decca SXDL 7512 / 390 184 / LDR-10013
* CD : Decca 448 987-2 / 400 046-2 (p 1982)
Durées : I. 13'53 (reprises) - II. 6'03 - III. 14'58 - IV. 4'20 - V. 9'30 = 48'51
2Y Diap. n° 254
« Voici donc une exécution somptueuse, d'une virtuosité étincelante (encore que certaines attaques, notamment dans le premier mouvement, ne paraissent pas impeccables --mais la prise de son est peut-être responsable), les tempos sont raisonnables, et jamais Zubin Mehta ne cède à la tentation du fantastique de pacotille et des effets raccoleurs. Lecture brillante mais honnête [...]. Nous écoutons un grand morceau d'orchestre jamais cet « épisode de la vie d'un artiste », avec ses folies et son spleen, sa verve imaginative. Il ne manque rien... sinon Berlioz. Dommage. » (Gilles Cantagrel, Diapason n° 254 - octobre 1980)


Mehta [2]
ø mai 1993 - London Philharmonic
* CD : Teldec 4509-90855-2 (p 1996 + Ouvertures) / Apex 685738953325
Durées : I. 14'48 (reprises) - II. 6'29 - III. 15'44 - IV. 4'39 - V. 9'40 = 51'50
7/9 Répertoire n° 7
« [...] Une qualité : la qualité de la prise de son. La définition des plans sonores, et surtout leur stabilité même au cours des passages à forte dynamique, a quelque chose d'hallucinant. C'est là l'occasion rêvée d'écouter vraiment l'orchestration de la Fantastique, de prendre conscience de mille petits événements qui d'ordinaire passent inaperçus. Mehta se prête de bonne grâce à ce petit jeu d'analyse, et soigne à l'extrême les équilibres et les contre-chants. A cet égard son premier mouvement, admirablement fouillé, est l'un des plus intéressants de la discographie. Malheureusement, Mehta semble renoncer ici à toute préoccupation d'impact émotionnel immédiat, et les deux derniers mouvements en tombent ainsi gravement à plat (il suffit d'écouter la fanfare finale de la « Marche au supplice », pour mesurer objectivement ce déficit). » (Laurent Barthel, Répertoire n° 70)
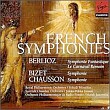
Menuhin
ø octobre 1990 - RPO
* CD : Virgin 5 61513-2 (+ Chausson, Bizet)
Durées : I. 13'55 (reprises) - II. 6'31 - III. 16'15 - IV. 4'35 - V. 9'51 = 51'38
6 Répertoire n° 118
Selmar Meyrowitz
ø 1934 - Orchestre Symphonique de Paris
* 78t : Pathé PDT 10-15
* CD : Historic Recordings HRCD 00037
« En 1935, Meyrowitz l'enregistrait pour Pathé ; à l'époque, la gravure avait paru saisissante et avait même mérité le grand prix de l'année. Réentendue aujourd'hui, on s'étonne de l'enthousiasme des discophiles d'alors : la direction de Meyrowitz ne présente aucune qualité qui nous pousserait à préférer sa version. » (Armand Panigel, Revue « Disques » n° 19/21 - décembre 1949)
Bruno Mezzena (piano)
ø 1976
* CD : CBS/Sony
* LP : Ricordi RCL 27006
Durées : I. 15'48 - II. 7'27 - III. 16'47 - IV. 5'33 - V. 12'12
2Y Diap. n° 246
« Berlioz et Liszt s'étaient connus en 1830, la veille de la création de la Fantastique. Liszt y assista, la réentendit à Paris en 1832, et décida alors d'en donner une version pour piano (1833), en même temps qu'il composait une pièce, Andante Amoroso, sur l' « l'idée fixe » de la Symphonie. Prodigieuse transcription d'un musicien de vingt-deux ans, d'une étourdissante habilité d'écriture. Les trouvailles pianistiques y abondent, les dérogations à la lettre du texte, aussi, pour mieux retrouver l'esprit de l'original, tenter de mieux rendre compte au piano de l'orchestre berliozien. [...] Hélas ! On ne retrouvera pas trace de cette éloquence [de Liszt] dans la consciencieuse exécution de Bruno Mezza. Les tempos terriblement lents étirent démeusurément le cheminement de l'oeuvre. Justice est rendu aux multiples subtilités de la partition (d'une difficulté redoutable), avec des nuances d'attaques, de toucher, de phrasé, d'intensité. Mais que tout cela semble appliqué ! [...] On rêve de ce que devriendrait cette folle partition sous les doigts d'un Horowitz, d'un Glenn Gould ou d'un Cziffra... » (Gilles Cantagrel, Diapason n° 246 - janvier 1980)
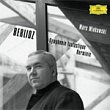
Minkowski
ø Concert Paris, Cité de la Musique, décembre 2002 - Mahler Chamber Orchestra / Musiciens du Louvre
* CD : DG 474 209-2 (p 2003 + Herminie)
Durées : I. 15'46 - II. 6'08 - III. 19'29 - IV. 6'20 - V. 9'11
8 Rép. n° 170 / 3Y Diap. n° 505 / 2* Monde n° 278
« Mon parcours d'auditeur est passé de l'indiférence polie à l'intérêt véritable, pour, au bout du parcours, retomber à l'état premier. Un point commun entre ces écoutes : on dresse l'oreille dans les trois dernières minutes de la Symphonie. Pour le reste il n'y a foncièrement pas grand-chose à reprocher à cette lecture très fouillée, minutieusement préparée, mais qui, à mon sens, manque de vie. » (Christophe Huss, Répertoire n° 170 p. 40 - juillet 2003)
« Le résultat est décevant dans l'immence Largo introductif, assez peu en place sur le plan des cordes. La fusion s'opère dans l'Appassionato assi mais retombe dans la cadence plagale. Le même scénario se reproduit dans la Valse, dont le mouvement devrait être celui d'un scherzo au phrasé aussi subtilement brillant qu'appuyé. Cor anglais et hautbois engagent un duo pastoral fort élégant dans la Scène aux champs que ne semblent pas vraiment menacer les grondements d'un orage bien lointain. Les deux dernier volets, beaucoup plus exigeants, ne sont pas conduits avec ce resserrement progressif du rythme qui en font d'ordinaire une musique orgiaque. » (Pierre-E. Barbier, Diapason n° 505 p. 78 - juillet 2003)
« Minkovski multiplie les effets, mais ne donne pas l'impression d'avoir une conception claire de ce qu'il dirige et oublie l'importance de la couleur orchestrale. A force de restreindre le vibrato, les archets du Mahler Chamber Orchestra et les Musiciens du Louvre ne trouvent jamais une vraie intensité, et l'orchestration de Berlioz en est aplatie. Il y a plus de précipitation que de passion et de rêverie dans le premier mouvement, plus de calcul que d'ivresse dans la valse, mais le plus décevant est sans doute la « Scène aux champs », non seulement par son extrême lenteur (dix-neuf minutes) mais surtout par son absence de mystère. Après cet alanguissement, l'excitation de la « Marche au supplice » nous sort de notre torpeur, mais cette sauvagerie de salon n'est pas réellement démoniaque. Le sens narratif fait défaut à Minkowski dans le finale, sans parler de quelques problèmes de mise en place. » (Pablo Galonce, Monde de la Musique n° 278 p. 78 - juillet 2003)



Mitropoulos [1]
ø [mono] Studio 27 février 1957 - P. New York
* LP : Columbia ML 5188 / Melodiya C10 14079-80 (p 1980) / CBS 78211 (p 1973) / CBS 61 465 (p 1974, Allemagne) / Philips "Réalités" n° C 12
* CD : Sony SICC 1600 (Japon) / CBS MPK 45685
Durées : I. Reverie. Passions (13'45) - II. Un Bal (6'31) - III. Scène aux Champs (14'58) - IV. Marche au Supplice (5'04) - V. Songe d'une Nuit de Sabbat (10'12)
9/6 Rép. n° 20 / 4Y Diap. n° 355 / 3d Compact n° 48
« Voilà une « Fantastique » fort déroutante... Mitropoulos, chef remarquable et habile, ne semble nullement gêné par des problèmes purement matériels que pose l'exécution de la «Fantastique» et, sur ce point, sa performance est en général très satisfaisante. Il en va tout autrement sur le plan du style : Mitropoulos aime-t-il et pénètre-t-il la musique de Berlioz ? C'est avec quelque incrédulité qu'on entend «interpréter» certaines des nuances de la partition, en négliger totalement d'autres, ignorer l'unité pourtant apparente de l'oeuvre, oublier jusqu'au sens de son titre : « fantastique » ... Il y a là une curieuse inertie dans le détail. Guère d'accent ni de caractère. Il n'est que d'écouter la «Rêverie» initiale - étirée, languissante - puis «Passions» - précipitée, nerveuse, si peu lyrique - pour juger de l'incohérence stylistique de cette interprétation. Mais l'absence d'élégance naturelle dont souffre le «Bal», le profil décousu, anecdotique de la « Scène aux champs », le manque de relief, d'acuité rythmique des deux derniers mouvements en donnent des aperçus non moins significatifs... » (Claude Dutru, Revue « Disques » n°104 - avril 1958)
« La version de Mitropoulos se caractérise d'abord par l'extrême cohérence stylistique qui unifie tous les mouvements en une véritable totalité organique là où d'autres ont tendance, y compris Markevitch ou Munch (Orchestre National) à privilégier inconsciemment tel ou tel mouvement ou tel ou tel aspect (Munch la passion, Markevitch la forme). Mitropoulos fait donc de la Fantastique une immence coulée musicale, puissante et équilibré. La valse est superbe de tenu et de chic : les tempi [sont] proches de l'idéal [...]. « Rêveries, passions » est peut-être le moment le plus original par sa prodigieuse vitalité interne obtenue par des jeux dynamiques très subtils et très fouillés des violons et des bois, ce qui accentue le bouillonnement inquiet. La « Scène aux champs » aurait gagné un peu plus de poésie (là Monteux est unique), mais la « Marche au supplice » est terrifiante par sa tension et rejoint la réussite de Markevitch. Quant au cébèbre « Songe d'une Nuit de Sabbat, seul Munch (Montaigne) fait mieux que Mitropoulos. » (Jean-Marie Brohm, Répertoire n° 20, décembre 1989, p. 30)
« Selon Mitropoulos, le plus important consiste à ne pas confondre romantisme et romanesque. Il en résulte un manque évident de séduction (lors de la Scène au champs, par exemple) mais sous la domination apparente de l'oeuvre (et indispensable exactitude), quel brasier ! » (F. Drésel, Diapason n° 355)
« Cette Fantastique de Dimitri Mitropoulos [est] inoubliable ! [...] Car d'une vérité, d'une intensité, d'une finesse psychologique constantes. Voyez le premier mouvement : tout y est vécu, chanté, «respiré» avec un sens exceptionnel des contradictions du héros (notez l'apparition presque brutale de l'«idée fixe»...) Cette lecture acérée, inquiète, virtuose en devient passionnante. De même la « Scène de bal » si libre dans son tournoiement, léger, souple et sans pathos. Les pâtres de la « Scène aux champs » ? Des gars simples, qui soufflent dans leur flutiau sans artifice, sans sophistication, mais de tout leur coeur : nous avons ici une leçon de naturel, de vérité qui ne nous lâche pas un instant, car sans la moindre baisse de tension. Cette vision lumineuse, «méditerranéenne que propose l'athénien Dimitri Mitropoulos eût d'évidence conquis, ravis l'auteur des Troyens. » (Jean Gallois, Compact n° 48)


Mitropoulos [2]
ø Concert Rochester, Eastman Theatre, 14 avril 1957 - P. New York
* CD : Urania URN 22.342 / Arkadia CDHP 562.2 / Hunt HUNTCD 562 + Requiem O. Radio Cologne (p 1989) / Hunt HUNTCD 582 - [Origine : Archive CBS Radio]
Durées : I. 13'36 - II. 6'19 - III. 14'51 - IV. 4'58 - V. 10'01
8/3 Répertoire n° 16 / 2d Compact n° 42
« Les tempos sont étonnamment retenus et l'aspect fantastique semble mis en retrait au profit d'une vision très sombre voire désespérée de la partition. En ce sens, le « Songe d'une nuit de Sabbat » s'avère être la crème la mieux réussie (dommage que les cuivres ne suivent pas toujours). Mais pourquoi freiner et surcharger à ce point la «Marche au supplice» ? » (Philippe Venturini, Compact n° 42)
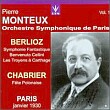


Monteux [1]
ø janvier 1930 - OS. de Paris
* 78t : RCA DM 111 / Gramophone W1100/W1105
* CD : Cascavelle VEL 3037 / Lys LYS 368 / Pearl 9012 (transferts : Seth B. Winner) / Music and Arts CD-4762
Durées : I. 12'46 - II. 5'42 - III. 15'55 - IV. 4'29 - V. 8'55 = 49'00
8/3 Rép. n° 62 / Diap. Historique n° 399
« Les enregistrements que nous offre Pearl, dans un son correct [...] nous révèlent une phalange remarquable, aux couleurs superbes, pleine de vivacité. Monteux garda toujours une tendresse particulière pour son premier enregistrement de la Symphonie fantastique. Quelle que soit la fraîcheur et l'inventivité de son travail il nous est quand même permis aujourd'hui de préférer ses gravures plus récentes [...]. Les fanatiques de Monteux, eux, n'hésiteront pas [...]. » (Laurent Barthel, Répertoire n° 62)
« Ce document témoigne déjà des justes contrastes rythmiques, du phrasé sûr, de l'étagement clair des parties qui feront tout le prix des six autres versions que Pierre Monteux enregistrera par la suite. » (Ch. Deshoulières, Diapason n° 454)
« Des cinq enregistrements que Monteux dirigea de la Fantastique, celui-ci n'est peut-être pas le plus intellectuellement mûri : mais c'est sans aucun doute celui qui possède la plus grande spontanéité expressive et technique, celui qui est le plus proche de l'esprit épique et fondamentalement romantique de la partition. Dès les premières mesure, Monteux instaure un climat dans lequel se combine tension nerveuse et sensualité. Usant des contrastes dynamiques les plus audacieux, respectant des tempos en parfaite adéquation avec le texte, il parvient à mettre en valeur chaque plan sonore avec une clarté que la prise de son antédiluvienne rend encore plus étonnante. L'éphémère Orchestre Symphonique de Paris, initié par La voix de son Maître, avait une vocation avant tout discographique. Peu d'ensemble français actuels pourraient s'enorgueillir de cordes à l'aisance si virtuose et de bois aux couleurs si naturellement chaudes. [...] Proprement démiurgique, la direction de Pierre Monteux dessine en effet une vaste fresque criante de vérité sonore. » (Emmanuel Dupuy, Diapason n° 399 p. 124)

Monteux [2]
ø San Francisco, War Memorial Opera House, 17-28 février et 15 avril 1945 - OS. San Francisco
* CD : RCA "Monteux Edition vol. 2" 09026 61894-2
Durées : I. 13'15 - II. 5'40 - III. 15'48 - IV. 4'49 - V. 9'28 = 49'16
9/5 Rép. n° 70 / Diap. d'or n° 406 / 3* Monde
« La Fantastique [...] est explosive à souhait et s'inscrit sans peine parmi les meilleurs de la discographie. [...] Un Berlioz enflammé, crépitant, diabolique [...] qui fait parler la poudre avec une rare subtilité de timbres et de phrasés. » (Jean-Marie Brohm, Répertoire n° 70 p. 79)
« Une formidable Fantastique, dramatique et inquiète, qui mérite son nom comme jamais [...] On retrouve des accents personnels, souvent identiques [à la version RCA de 1950], dans les deux enregistrements, mais la préférence peut être accordé au plus ancien » (Rémy Louis, Diapason n° 406 p. 86)

Monteux [3]
ø Concert Amsterdam, 20 mai 1948 - O. Concertgebouw
* CD : Tahra TAH 175-178 (+ Brahms, Sibelius, Stravinsky) - [Origine : Archive Radio Vara]
Durées : I. 13'02 - II. 5'41 - III. 15'50 - IV. 4'40 - V. 8'57 = 49'00
Monteux [4]
ø 27 février 1950 - OS. San Francisco
* LP : RCA GM 43 359 / Emi/VSM FALP 118 (p 1952)
Durées : I. 12'53 - II. 5'40 - III. 15'46 - IV. 4'45 - V. 9'20
« Une oeuvre couronnée à deux années d'intervalle (la version Munch en 1950), cela doit-il faire croire que le jury du Grand Prix du Disque manquait d'imagination ou qu'il s'est trouvé, cette année misérablement restreint ? Non ! ...Il était en présence d'une réussite telle que seul un prix pouvait exprimer son admiration... Pierre Monteux a signé là l'une des plus belles éditions de sa carrière vouée à la musique. » (Henry-Jacques, Revue « Disques » n° 46 - mars 1952)


Monteux [5]
ø Vienne, Sofiensaal, 20-24 octobre 1958 - Philharmonique de Vienne
* LP : RCA SB 2090 / 640675
* CD : Decca 461 054-2 / "Vice-Versa" 460 452-2 (p 1998) / Decca "Caractère" 444 341-2 (p 1995) / Haydn House HH1010
* SACD : Praga Digitals DSD 350071 (+ Nuits d'été extraits : II-VI/Mitropoulos-1953)
Durées : I. 13'59 - II. 6'02 - III. 16'20 - IV. 4'51 - V. 9'44
9/7 Rép. n° 79 / Diapason d'or n° 418 p. 98, 5Y avril 2013 / 4* Monde n° 188
Ce n'est pas sans une certaine ironie que je rapproche ces textes on ne peut plus contradictoires...
« ... Quant à la version Monteux dont les berlioziens n'ont pas oublié l'ancienne version (San Francisco), inégalée jusqu'à ce jour, elle est proprement hallucinante : le « génie » de Monteux n'aura-t-il donc jamais fini de nous surprendre : quelle jeunesse et quelle fièvre dans son interprétation, « maléfique » à souhait - dans le sens où les entendaient les romantiques ! Ecoutez les incertitudes, les sursauts, les révoltes et puis l'apaisement du 1er mouvement, la « méchanceté » avec laquelle il aborde la scène du « Bal », qu'il presse à dessein et où il réussit une extraordinaire « surimpression » du thème de la Bien-Aimée sur le fond de la danse ; admirez la couleur byronienne qu'il impose à la « Scène aux champs », l'angoisse de la « Marche au supplice » imposée dès les premières mesures et où l'on entend enfin les « terribles » basses des cuivres ; le sarcasme, la grimace et puis le déchaînement qui président au « Songe d'une nuit de Sabbat ». » (R.M. Hoffman, Revue « Disques » n° 122 - 1961)
« En octobre 1958, lorsque Pierre Monteux réenregistre la Symphonie Fantastique avec l'Orchestre viennois (après l'avoir fait à deux reprises à San Francisco en 1945 et 1950), il pense avoir enfin à sa disposition tous les éléments pour réaliser un bon enregistrement. Tout d'abord, l'orchestre est réputé pour ses timbres particuliers « à l'ancienne », même s'il sont assez loin de la tradition française représenté par l'Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire de Paris, au point d'apparaître carrément opposés, ensuite, une équipe de chez Decca va assurer la prise de son pour le compte de RCA, et enfin la salle, de vaste dimensions, est renommée de longue date pour ses qualités acoustiques. Le résultat ? Un enregistrement qui n'est que l'ombre de ce qu'il aurait pu être. En premier lieu, la qualité des timbres et les sonorités de l'orchestre sont à notre avis, parfaitement viables pour ce répertoire, celles-ci étant d'une certaine façon « diabolisées » par Pierre Monteux qui sait les restituer avec une acuité stupéfiante. Est-ce que certains instrumentistes avaient des difficultés à le suivre qu'il perdit à la longue sa spontanéité ? Toujours est-il qu'il s'enlise dès le premier mouvement et qu'il s'empêtre dans les méandres d'une exécution laborieuse, lente et pesante, sans vie aucune, qui n'a rien à voir avec ses précédentes prestations avec l'Orchestre Symphonique de Paris et le San Francisco Symphonie Orchestra. Certains critiques français, comme toujours peu attentifs à la véritable personnalité du chef, encensèrent cet enregistrement, alors que non seulement le maestro lui-même ainsi que son épouse le désapprouvaient (*), mais qu'il était en plus de ses incontestable déficiences orchestrales, défectueux sur le plan technique, surtout au niveau de l'équilibre de certains pupitres. A maintes reprises, des traits instrumentaux sont pratiquement inaudibles, car ils n'ont tout simplement pas été captés par les microphones et, en divers endroits, ils sont «couverts» par d'autres instruments qui les écrasent. »
« (*) [...] « Ca a toujours été mon opinion que les disques de cette oeuvre que j'ai faits à la tête de l'Orchestre Symphonique de Paris sont, de loin, les meilleurs que j'ai réalisés. Aujourd'hui encore, je préfère écouter ces vieux enregistrements.» [P. Monteux] Il est tout naturel que Pierre Monteux utilise le mot disque au pluriel, car à l'époque du 78 tours, les cinq mouvements de cette longue symphonie n'en nécessitaient pas moins de six. » (Jean-Philippe Mousnier, Pierre Monteux. L'Harmattan, 1999, p. 258/259 et extrait de la note 33.)
« La distinction suprême de la pâte [orchestrale], la précision raffinée des couleurs, la verve jubilatoire, le mystère haletant de l'instant, la clarté et la cohérence de la construction, restituent avec génie l'indicible poésie du message berliozien. » (Jean-Marie Brohm, Répertoire n° 63 p. 11)
« Avec cette gravure historique entre toutes [...] on dispose enfin des principales versions que nous a léguées Monteux. Ici, avec une bonne prise de son (1958) et une Philharmonique de Vienne ramassée sur elle-même, d'une densité harmonique extraordinaire, Monteux impose une conception à la fois classique et racée. La clarté de la construction, la densité musclée des dynamiques s'ajoutent à la précision des dosages de timbres et surtout à la sveltesse du relief, jamais surchargé, ni racoleur, comme dans tant de versions ultérieures qui confondent hystérie technicolor et flamme romantique. Cette Fantastique là n'est peut-être pas la plus délirante [...] ni même la plus diabolique [...] mais sa nervosité, sa subtilité («un Bal» magnifique) sa «fougue réglée» pour utiliser une expression de Berlioz, la verve jubilatoire de l'orchestre d'une vitalité prodigieuse sur tous les pupitres (la coda du « Songe d'une nuit de sabbat » !), la poésie onirique surtout qui s'en dégage font de cette gravure déjà légendaire une référence absolue. » (Jean-Marie Brohm, Répertoire n° 79)
« La splendide Fantastique de Pierre Monteux, enregistré sauf erreur, en 1961 [sic !!!], est indispensable à trois titres. L'excellence de la prise de son Decca la rend supérieure à toutes les autres gravures du chef français ; la splendeur de la Philharmonie de Vienne est un enchantement de tous les instants ; enfin bien sûr, la direction de Monteux est précise, élégante, frémissante, merveilleusement juste. Si toutes ses gravures de cette partition sont évidemment essentielles, et si l'on se gardera de contredire le propre jugement du chef qui plaçait avant toute autre la version de l'Orchestre Symphonique de Paris de 1930, la réédition viennoise n'en comble pas moins une lacune importante du catalogue. » (Jean Claude Hulot, Diapason n° 418 p. 98)
« [Cet enregistrement] est l'un des plus extraordinaires de l'entière discographie. L'exécution est d'une précision transcendante, le style impéccable, les timbres magnifiques. Monteux équilibre mieux encore que tous ces meilleurs rivaux dans cette oeuvre [...], la rigeur et l'électricité, l'intelligence du texte et la fulgurance de l'expression, ici débarrassée de toutes les scories qui encombrent les interprétations habituelles de l'oeuvre. » (P. Szersnovicz, Monde de la Musique n° 188 p. 88)
Monteux [6]
ø Concert New York, Carnegie Hall, 28 février 1959 - P. New York - [Archive radio Voice of America]
* LP : Paragon LBI 53002 (p 1981)
* CD : Disco Archivia 624 (date : 27 février + Empereur/Serkin/Beethoven)
Durées : I. 13'15 - II. 5'53 - III (1re partie). 8'28 + 7'10 - IV. 4'44 - V. 9'37
Monteux [7]
ø 5 mai 1961 - LSO - [Inédit ]

Monteux [8]
ø Concert Vienne, Musikverein, 4 juillet 1962 - O. Concertgebouw
* CD : Tahra TAH 541-542
* CD : (p 2004 + 1e Concerto piano/Backhaus/Brahms)
Durées : I. 14'09 - II. 6'21 - III. 16'44 - IV. 5'05 - V. 10'21
Monteux [9]
ø 22 novembre 1962 - LSO - [Inédit ]

Monteux [10]
ø Concert février 1964 - OS. NDR Hambourg
* LP : Guilde Internationale du Disque SMS 2357 (p 1964) / Tono SMS M-2357 / Edito / Festival Classique FC 404 / Vox Turnabout 34616
* CD : Scribendum SC 013 / Repérage 75.1303 / Guilde Internationale du Disque GID CD113 (p 1989)
Durées : I. 13'47 - II. 5'55 - III. 15'20 - IV. 4'55 - V. 9'58 = 50'22
9/6 Rép. n° 10 / Diap. d'or n° 346 / 3d Compact n° 38
« On retrouve, bien sûr, l'ampleur et la clarté d'une direction qui ne laisse aucun détail dans l'ombre tout en mettant en évidence les lignes de forces de la Symphonie Fantastique. Ce qu'il y a de merveilleux chez Pierre Monteux - et de très rare - c'est qu'il effectue tout naturellement la synthèse de la logique et de la passion. » (Jean Roy, Diapason n° 346 p. 106 - février 1989)
« Avec l'Orchestre Symphonique du Norddeutcher Rundfunk de Hambourg, on « devine » les intentions du chef, tout ce qu'il avait à nous faire découvrir. Malheureusement l'orchestre n'a ni le moelleux ni la transparence ni les fabuleux coloris des Viennois. Le style est certes merveilleusement idéalement adapté à l'oeuvre : fiévreux, précis, romantique à souhait, avec une pointe de retenue toute classique. Avec surtout une poésie, une verve éminemment « berlioziennes ». Mais les instrumentistes ne nous peuvent convaincre totalement. » (Jean Gallois, Compact n° 38)
Monteux [11]
ø Concert 12 avril 1964 - RAI
* CD : Disco Archivia 636 (+ Wagner, Prokofiev)
Mravinski
ø studio Moscou, 1949 - OS. Etat d'URSS
* 78t : Melodiya 16695/6
* LP : Melodiya WERM3-67
Deuxième mouvement seulement
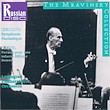
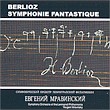
Mravinski
ø [mono] Concert Leningrad, Grande Salle Philharmonie, 26 février 1960 - OP. de Leningrad
* CD : Russian Disc "The Mravinsky collection" RD CD 10 906 (p 1995 + Pavane, Bolero Ravel) / Venezia CDVE 03219
Durées : I. 13'23 - II. 6'00 - III. 14'40 - IV. 4'22 - V. 9'49
Munch [1]
ø Concert 1948 - P. New York - [Archive radio ]

Munch [2]
ø Théâtre des Champs-Elysées, 5 juillet 1949 - O. National de la RTF
* Matrix : SOFX 19 à SOFX 30
* 78t : Columbia LFX 880-885
* LP : Emi/Trianon 6104trx / XLX 751
* CD : Tahra TAH 528-529
* CD : (p 2004) / Cascavelle VEL 3112 (p 2007 + Roméo et Juliette) / Artone (Membran) 222357-354 (p 2006) / A Classical Record ACR 40/41 (p 1997) / A Classical Record 40 (date 1945)
Durées : I. 12'35 - II. 6'06 - III. 14'18 - IV. 4'22 - V. 8'29 = 43'00
5Y Diap. n° 515 / Grand prix du disque de l'Académie Charles Cros, 1950
« Dirigeant avec une maîtrise absolue l'orchestre de la radiodiffusion française, Ch. Munch a redonné à cette oeuvre un éclat qui éteint les couleurs des autres... Grâce à sa maîtrise, M. Charles Munch a même réussi le miracle de rendre moins exagérément longues certaines pages un peu bavardes de la partition. Et, dans sa direction du « Sabbat », il a dirigé la musique du diable avec l'assurance d'un vieil exorciseur. Une fois de plus, nous avons été, non pas émus, cette émotion-là n'est plus de notre temps, mais admirablement amusés. Et s'il faut, à de très vifs éloges, interférer une légère critique, disons simplement que la « Valse » ne nous semble pas suffisamment « sylphidienne »... » (Henry-Jacques, Revue « Disques » n° 19/21 - décembre 1949)
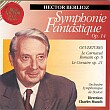

Munch [3]
ø [mono ou stéréo] 14-15 novembre 1954 - OS. de Boston
* LP : RCA A 630301 / RCA Victor LM 1900 (P 1955) / RCA Victor LSC 1900 (Classic
Records Reissue) / RCA Victrola 940 001/004 ou 950 001/004 (p 1968 + op. 24) / RCA 640.722 / RCA AGL1-5203 / RCA Gold Seal GL 85203 (p 1986) / HMV ALP 1384
* CD : RCA "Red Seal" 900 245-2 / "Living Stereo" 9026-68979-2 / 68444 / RCA Red Seal RD 86210 (P 1987, + op. 5) / RCA Gold Seal 09026-68444-2 (p 1996 "Munch conducts Berlioz") / RCA Living Stereo 09026-68979-2 (p 1998) / RCA 74321-56861-2 (RCA Japon BVCC-7914, p 1998 "The immortal art of Charles
Munch, vol. 13") / RCA Red Seal 82876-60393-2 (p 2004 "Munch conducts Berlioz", Complete collection) / RCA Living Stereo 82876-67899-2 (p 2006 + Roméo et Juliette) / RCA 74321-56861-2 (RCA Japon BVCC-38431 p 2006 + "The art of Charles Munch, vol. 9")
Durées : I. 13'13 - II. 6'09 - III. 13'55 - IV. 4'28 - V. 8'41 = 46'40'
10 Rép. n° 125 p. 74 / Diap. d'or n° 462
« ... Il nous faut confesser une légère déception. Tout d'abord les «pianissimi» ne sont pas toujours respectés, d'autre part la réalisation orchestrale n'est pas aussi parfaite qu'on pourrait l'attendre d'un tel orchestre et d'un tel chef... Dans le 1er mouvement, Munch attaque l'allegro une mesure avant l'endroit indiqué par Berlioz... «La Valse» de Munch est plus proche (que celles de Cluytens et Karajan) de celle que Berlioz a conçue mais il ne transpose et n'idéalise pas ce morceau comme Markévitch... C'est dans la «Scène aux Champs» que nous retrouvons le mieux le grand Munch que nous aimons... Dans la «Marche au supplice», Munch nous réserve encore une surprise : il adopte un mouvement plus lent que tous ses concurrents. La lenteur atténue, à mon sens, le caractère hallucinant du cauchemar... Dans le «Finale», c'est ici que Munch nous déçoit le plus curieusement : il adopte dans la «ronde» un tempo incroyablement rapide (noire = 138 au lieu de 104 indiqué par Berlioz)... L'exécution est souvent confuse et le rythme n'est pas toujours absolument précis. » (H.L. de la Grange, Revue « Disques » n° 83/84 - Noël 1956)
« Deux gravures dominent [...] : la « mono » de 1954 et la stéréo de 1962 (les différences de conception s'avérant minimes : des tempos légèrement plus retenus et des coloris plus raffinés en 1962). En 1996 un coffret RCA [...] présentait la mouture stéréo (enregistrement effectué simultanément avec celui en mono, les 14 et 15 novembre 1954). Un peu d'histoire très simplifiée de la technique d'enregistrement s'impose - du moins pour cette firme. Le premier essais de stéréo chez RCA eurent lieu le 6 octobre 1953 sous l'appellation de « binaural », avec un matériel d'enregistrement deux-pistes et trois micros dont un central se partageant de surcroît les deux voies [...]. Bref, depuis l'exhumation de ce fougueux enregistrement de 1954 très bien « remastérisé », on ne sait plus quelle Fantastique bostonienne de Munch choisir ! » (Francis Drésel, Répertoire n° 125 p. 74)

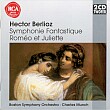
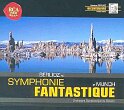
Munch [4]
ø Boston, Symphony Hall, 9 avril 1962 - OS. de Boston
* LP : RCA Victor LM ou LSC 2608 (p 1962) / RCA Red Seal FVL3-7033 (p 1974) / RCA Victrola VL 42711 (p 1978, in "Munch-Berlioz" coffret 11 LP) / RCA Victrola AVL1-0898 (p 1978) / RCA Gold Seal AGL1-5203 (p 1983)
* CD : RCA "Twofer" 74321 34168-2 (+ Roméo et Juliette) / RCA Victrola 7735-2-RV ou VD 87735 (P 1988) / RCA 74321-34168-2 (p 1997, + op. 17) / RCA 74321-56866-2 (RCA Japon BVCC-7918/19, p 1998 "The immortal art of Charles Munch, vol. 16") / RCA Red Seal 74321-84587-2 (p 2002, Artistes repertoires) / RCA 74321-98655-2 (p 2003) / RCA Red Seal 82876-60393-2 (p 2004 "Munch conducts Berlioz", Complete collection) / RCA Red Seal
82876-87392-2 (p 2006) / RCA 74321-56866-2 (RCA Japon BVCC-38441/42 p 2006 "The art of Charles Munch, vol. 15") / RCA Japon BVCC-37605 (p 2007)
Durées : I. 13'54 - II. 6'22 - III. 14'56 - IV. 4'24 - V. 9'16 = 49'08
10/7 Rép. n° 103 / Diap. d'or n° 440
« On ne s'étendra pas sur cette Fantastique que tout mélomane doit connaître : incendiaire elle fut, incendiaire elle demeure, écoute après écoute, et l'on oublie toute idée de réinterprétation après une telle aventure musicale. » (Eric Taver, Diapason n° 440)
Munch [5]
ø Concert Tokyo, Bunka Kaikan, 28 décembre 1962 - Japan Philharmonic Symphony Orchestra
* CD : Exton OVBC-00016 [Vidéo] (p 2003)
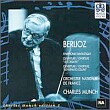
Munch [6]
ø [mono] Concert Lisbonne, 23 juin 1963 - O. National de France
* CD : Valois "Chales Munch édition vol. 2" V 4826 (p 1998 "Charles Munch edition") / Montaigne MUN 2011 (p 1988)
Durées : I. 13'25 - II. 5'50 - III. 13'06 [coupure ms. 154-171] - IV. 3'52 - V. 8'31 = 45'33
9/6 Rép. n° 6 / 4d Compact n° 43
« L'intérêt de cette version est de nous faire entendre un Munch inquiétant, presque fanatique. Se battant furieusement contre le matériau sonore qui lui résiste avant de ployer sous son impulsion magnétique, il nous livre ici une interprétation littéralement délirante, fantasque, convulsive au possible. Un lecture dérangeante parce qu'elle exacerbe ce qui ne manque pas d'irriter les adversaires de Berlioz et de son interprète d'exception : la liberté rythmique incessante, une pulsation frénétique, un goût pour les fresques visionnaires, le sens de l'hallucination, l'art du paradoxe si important chez Berlioz où le grotesque et le sublime alterne en permanence. « Rêverie-Passions » est crépusculaire, erratique. «Un bal» nous emporte dans la fièvre, morbide, la «Scène au champs» est traversée de réminiscence menaçante tandis que la «Marche au supplice» est sinistre au possible. C'est surtout la «Nuit de Sabbat» qui nous vaut de furieux tumultes. Dans un tempo infernal [...], Munch déchaîne tous les excès. L'orchestre, dans un état second, se laisse emporter dans un moment de pure folie où les miasmes infernaux, les crépitements ensorcelés conduisent à une sensationnelle coda : l'Orchestre National ébranlé, mais vaillant, participe à son propre embrasement. Un moment exceptionnel que restitue correctement une prise de son honnête et où les quelques faiblesses des musiciens du National sont transcendés par un Munch qu'ils adoraient et à qui ils auraient tout permis, y compris, sans doute, une excursion démoniaque. » (Jean-Marie Brohm, Répertoire n° 9)
« Si le public est bien bruyant et fort enrhumé, le chef, lui, reste égal à lui-même et s'enflamme. A vrai dire, les Rêveries ne sortent guère d'un rêve : avec Munch on est immédiatement plongé dans les passions les plus exacerbées. Le Bal devient alors fantastique tourbillon où les pizzicatos frémissent de pulsions nerveuses. La Scène au champs, prise également dans un tempo très vif, débouche sur une Marche au supplice qui devient une vraie charge de cuirassiers. Et le Songe d'une nuit de Sabbat, par ses aspect grinçants en vient à nous donner la chair de poule. » (Jean Gallois, Compact n° 43)

Munch [7]
ø Concert 19 décembre 1963 - OS. Radio Canada
* CD : VAI VAI- 4273 (DVD p 2011) / VAI/Radio Canada [Vidéo] VHS 69427 (p 2000) / VAI DVD 4273 (p 2004 + Les Nuits d'été
/ Horne et Hétu)
Durées : I. 12'48 - II. 6'15 - III. 12'07 (coupure) - IV. 4'10 - V. 8'50
Munch [8]
ø Concert 1964 - OS. de Boston - [Archive radio ]
Munch [9]
ø Concert Budapest, studios Radio Hongroise, avril 1966 - O. Radio Hongroise
* LP : Philips/Hungaroton SLPX 11 842 (p 1976) / Fidelio FL 3349 (p 1985)
* CD : Philips 426 103-2 (p 1989) - [Origine : Radio Hongroise]
Durées : I. 14'04 - II. 6'58 - III. 13'57 - IV. 4'0/ 2 - V. 9'57 = 49'50
1Y Diap. n° 213 / 3d Compact n° 53
« En 1966, la gravure entreprise avec l'Orchestre Symphonique de Budapest dure 49 minutes. un pareille variation [par rapport aux 43' avec l'ORTF, en 1964] a-t-elle sa source dans les soubresauts propre à l'âme de Charles Munch ? On a le droit d'en douter à l'écoute de la phalange danubienne, cent fois plus familière des Danses de Galanta de Kodaly ou du Mandarin Merveilleux que des arcanes du romantisme français. Sans faire du mauvais esprit, ne se livrer à des exagération déplacées, il semblerait bien qu'une partie des instrumentistes hongrois reste, dans ce disque, au stade d'un déchiffrage habile, d'un décryptage qui incite le chef à prendre une relative modération dans l'allure générale. » (Philippe Olivier, Charles Munch. Belfond, 1987 p. 118)
« Le revoici, comme le furet du bois joli, en 1966, avec les Hongrois. Ceux-ci se donnent à plein, mais avec parfois, un peu de roulis et de tangage (1er mouvement). Le chef, de son côté, ne parvient qu'imparfaitement à tisser le lien nécessaire entre certains moments d'un même acte et se montre soit indécis (Scène du bal), soit nerveux. Restent les deux dernier mouvements ; emportés par la fougue du chef, ils souffrent d'un léger manque de contrastes (4e mouvement). Mais c'est là une réserve qui se trouve balayée dans le final par la force persuasive de Munch... Il n'empêche : avec l'Orchestre de Boston nous atteignions d'autres sommets... » (Jean Gallois, Compact n° 53)
Munch [10]
ø juillet 1966 - OS. de Chicago
* CD : Parnassus special edition

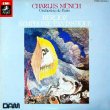

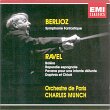
Munch [11]
ø Paris, Salle Wagram, 23-26 octobre 1967 - Orchestre de Paris
* LP : EMI 2C 069-10595 / SME 91 685 / VSM CVAP ou VCL ou CVB 2037 / HMV ASD 2342 / Angel DOR-0123/4 (45 tours, Japon) / Angel S 36517 (p 1968) / VSM 2C 165-52511/14 (p 1977 "L'Orchestre de Paris et Charles Munch") / Angel RL 32061 / Electrola SME 91685
* CD : Emi 7243 5 72447 2 (+ Ravel) / CDC 7 47372-2 (p 1984) / 1 10595 2 (p 1986) / 7 69957 2 (in 'Charles Munch et L'Orchestre de Paris') / EMI Toshiba TOCE-14001 (p 2007) / TOCE-90012 (p 2008)
Durées : I. 13'45 - II. 6'15 - III. 14'50 - IV. 4'28 - V. 9'45 = 48'50
8/6 Rép. n° 108 (9/6 rép. n° 63 - comparatif)
« La plus longue de ses quatre versions [de studio] de l'oeuvre, elle puise son caractère exceptionnel grâce à l'enthousiasme juvénile mis par ce bâtisseur dans un projet riche en promesses [: l'Orchestre de Paris a été fondé il y a un mois]. Le chef oublie, ici, ses soixante-seize ans. Il conduit comme un jeune homme amoureux. Sans négliger, pour autant, une expérience de plusieurs décennie. Chaque phrase, le moindre des accents en portent la marque. L'immense et inépuisable générosité du maestro fait le reste. Un miracle se produit. Au terme de multiple écoutes, il demeure. » (Philippe Olivier, Charles Munch. Belfond, 1987 p. 119)
« On y retrouve une patte caractéristique, avec cette lecture hallucinée, ces flottement rêveurs et fantasmagoriques et la réserve de puissance que Munch savait déchaîner avec l'urgence et l'intuition qu'on lui connaissait, «Rêverie et passions», l'intitulé du premier mouvement, c'est la signature même de Charles Munch. Chaleureuse, fougueuse, mais aussi démoniaques dans la Marche au supplice et la Nuit de Sabbat, sa direction reste un modèle de romantisme débridé et d'extraversion. Qu'ils sont loin les Boulez calculateurs et les Karajan sophistiqués de ce naturel sanguin et de cette ivresse communicative ! Bien sûr on continuera à préférer la version Boston pour son accomplissement orchestral supérieur, mais on aurait tort de négliger cet enregistrement [...]. » (Philippe de Souza, Répertoire n° 108)
Munch [12]
ø Concert Paris, 14 novembre 1967 - Orchestre de Paris - [Archive radio ]
Il s'agit du concert inaugural de l'orchestre.
Roger Muraro (piano)
ø 2011
* CD : Decca B004EU7VXG

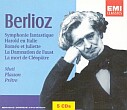
Muti
ø 1985 - O. Philhadelphie
* LP : Emi EL 270235-1
* CD : Emi CDC 7 47278-2
Durées : I. 15'34 (reprises) - II. 6'09 - III. 16'01 - IV. 6'43 (reprises) - V. 9'41 = 44'29
Rép. n° 163 / 3Y Diap. n° 308
« L'Orchestre de Philadelphie brille ici de tous ces feux, éclate de tous ses tonnerres et triomphe évidemment, dans le Songe d'une nuit de Sabbat traité un peu comme un concerto pour orchestre, ce qui est une des conceptions possibles de cette page où Berlioz a joué d'abord sur la couleur et sur le timbre. Mais Riccardo Muti accentue par trop les effets pittoresques de la Symphonie fantastique, de telle sorte que la continuité de l'oeuvre passe au second plan. Dans Rêverie-Passions, malgré la belle couleurs orchestrale, on ne retrouve ni l'émotion de Munch, ni le naturel de Barenboim. » (Jean Roy, Diapason n° 308 p. 64 - septembre 1985)
Toutes suggestions, corrections ou informations
supplémentaires sont bienvenues !
http://patachonf.free.fr/musique